L’église paroissiale de Canohès est un bel édifice de style roman, remanié à plusieurs reprises. Elle conserve des éléments très anciens tout en présentant des modifications réalisées au fil de son histoire. Aujourd’hui, elle trône au centre de la ville, au point le plus élevé, comme c’est souvent le cas dans les communes environnantes.
La partie la plus ancienne de l’église semble remonter au XIe siècle, en pleine période romane. C’est du moins ce que laisse penser le style classique des absides en hémicycle décorées d’arcatures, visibles ici. On y trouve également de lourds piliers très larges, caractéristiques de cette époque. Le matériau de construction, en revanche, ne l’est pas : il s’agit de galets de rivière, un matériau banal utilisé jusqu’au milieu du XXe siècle, qui ne reflète pas l’époque de construction. À l’inverse, la fenêtre à deux arcs géminés est typique du XIe siècle, avec une colonne centrale massive et un chapiteau sculpté. La porte d’entrée était autrefois située sur la façade sud et devait être décorée d’un portail sculpté. À cette époque, la toiture était en charpente de bois, car l’on ne maîtrisait pas encore la construction de voûtes solides. L’église initiale, bâtie sur des vestiges de l’Empire romain, était plus étroite qu’aujourd’hui. En effet, au XIIe siècle, la charpente fut remplacée par une voûte, et deux nefs latérales furent ajoutées. Les murs d’origine servirent alors de contreforts pour soutenir la nouvelle voûte.
Aux XIVe, puis XVe siècles, le chevet fut renforcé par l’ajout de deux contreforts. C’est également de cette époque que datent les peintures visibles sur la voûte de l’abside. Les modifications suivantes sont bien plus tardives : en 1842, d’importants travaux de réfection furent entrepris sur la porte, le toit et le clocher. Un nouveau portail fut percé, celui que l’on connaît aujourd’hui. En 1876, le curé de la paroisse, un certain abbé Courp, fit percer le mur nord sous les arcades, puis fit de même côté sud deux ans plus tard. Ces travaux, entrepris sans grande réflexion, provoquèrent l’effondrement de la voûte. En 1884 commencèrent alors les travaux de réparation, qui consistèrent à créer deux arcades méridionales en brique. Il semblait alors évident qu’il était impossible de reconstruire la voûte ; une charpente en bois fut donc installée, recouverte d’un enduit pour lui donner l’apparence d’une voûte. Les travaux durèrent jusqu’en 1887, année où le culte put enfin reprendre dans l’église.
Durant le XXe siècle, l’église fut dotée de plusieurs statues, d’un maître-autel, de vitraux et de chapelles latérales. Les travaux de restauration suivants furent entrepris en 1966 et portèrent sur l’intérieur de l’édifice. On restaura les murs et les colonnes de l’abside, les deux fenêtres est et sud, ainsi que les peintures du XIVe siècle sur la voûte. Si vous êtes curieux, sachez que la cage entourant la cuve baptismale en marbre est tout ce qu’il reste de l’escalier en fer menant à la tribune, autrefois située au-dessus de l’entrée.
L’église est dédiée à Saint Cyr et Sainte Julitte. Saint Cyr est également connu sous le nom de Quir (en catalan). Il était le fils de Julitte, qui vivait en Cilicie (Asie Mineure), précisément à Tarse. Julitte fut martyrisée avec son fils Cyr, alors âgé de seulement trois ans, ce qui explique leur reconnaissance comme saints dans la tradition catholique.
Les fresques du chœur
S’il y a bien un élément de l’église de Canohès qui attire immédiatement l’œil, c’est cette grande fresque située au-dessus du chœur. Elle semble très ancienne et magnifiquement restaurée. C’est en partie vrai, mais en réalité… elle est presque contemporaine !
En effet, nous savons que les églises romanes étaient autrefois richement décorées : les murs étaient couverts de peintures décoratives aux couleurs vives. De nos jours, il ne subsiste généralement que des traces de ces œuvres (à l’exception de quelques cas remarquables). Dans les années 1970, le curé de Canohès entreprit de dégager les différentes couches d’enduit accumulées au fil du temps sur les murs du chœur. Il mit alors au jour quelques fragments de peintures datant du XIVe siècle. Toutefois, ce n’est qu’en 2021 que le nouveau curé, en accord avec la mairie, fit repeindre la fresque dans le style de l’époque, en y reproduisant volontairement des traces d’usure dues au temps. Une initiative originale, qui donne l’illusion d’une fresque authentique du XIVe siècle bien conservée, alors qu’il s’agit en grande partie d’une œuvre contemporaine.
Cela dit, certains éléments du décor sont bel et bien authentiques : on peut en voir au-dessus de la fresque, mais également intégrés directement dans celle-ci, mêlés à l’œuvre contemporaine.
Vous comprendrez ainsi pourquoi la partie centrale représentant le Christ dans une mandorle semble parfaitement conservée : elle n’a volontairement pas été « vieillie », contrairement au reste de la composition.
Les peintures modernes ont été réalisées par l’artiste Pierre Henri Rousseau, spécialiste des œuvres religieuses.


















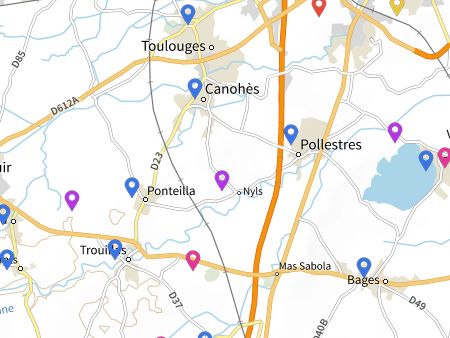
 Les Pyrénées-Orientales
Les Pyrénées-Orientales