Les Pyrénées-Orientales est un département à la fois côtier et montagneux, avec de hauts pics pyrénéens, de la moyenne montagne, et une plaine agricole. Tout cela nécessite une gestion minutieuse de l'eau. Pendant un temps, le Conseil Général rappelait, à juste titre, que ce département avait une chance incroyable : une goutte d'eau tombant dans le département y reste. Bien que ce ne soit pas tout à fait exact, c'est très proche de la réalité. Quatre bassins versants principaux alimentent les terres Nord-Catalanes : trois alimentent les trois fleuves côtiers et le quatrième alimente le Sègre, en Cerdagne, qui se jette dans l'Èbre avant de rejoindre la mer. Il existe d'autres bassins versants, comme celui du Capcir, mais ils sont moins importants.
L'hydrologie du département des Pyrénées-Orientales se caractérise par sa diversité. Elle comprend un ensemble de rivières, certaines côtières, des étangs le long du littoral, des retenues artificielles ou naturelles, principalement en moyenne et haute montagne, ainsi qu'un impressionnant réseau de canaux d'irrigation. Ces derniers sont hérités du Moyen Âge, une époque où le percement d'un canal permettait non seulement d'apporter de l'eau pour la consommation ou l'irrigation, mais aussi de fournir de la force mécanique : un canal assurait la présence d'un moulin, un moteur mécanique de l'époque. Et un moulin permettait d'obtenir facilement de la farine et de l'huile, éléments de base de l'alimentation.
Les fleuves et rivières
Le département des Pyrénées-Orientales est traversé par cinq rivières, dont trois sont des fleuves côtiers. Le paysage s'est formé autour de ces trois fleuves principaux, et la forme même du département semble avoir été dessinée pour suivre leurs lits.
Géographiquement, il est donc facile de comprendre l'hydrologie du département. Voici une carte indiquant ces trois fleuves. Le plus au nord est l'Agly, qui prend sa source dans le département limitrophe de l'Aude, au nord, et se jette juste sous l'étang de Salses. Le second, la Têt, est le plus long et suit son cours jusqu'à la Cerdagne. Le troisième, le Tech, est plus petit et tumultueux, ressemblant davantage à un grand torrent, bien que la sécheresse actuelle l'ait rendu plus calme.
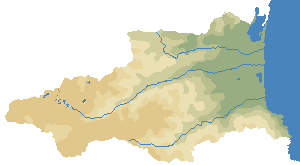
Les deux autres fleuves ne sont pas côtiers. L'Aude, qui a donné son nom à un département, prend sa source dans le Capcir au nord. Le Sègre, qui effectue une boucle en Cerdagne avant de rejoindre l'Espagne puis l'Èbre, prend sa source dans une vallée pyrénéenne.
En dehors de ces cinq fleuves, les Pyrénées-Orientales comptent 260 cours d'eau, soit 1 085 km de rivières (1er catégorie piscicole), et 15 cours d'eau, soit 311 km de rivière (2e catégorie piscicole). Voici une description plus détaillée de ces cinq fleuves.
L'Agly
L'Agly, le plus septentrional des fleuves des Pyrénées-Orientales, prend sa source dans le département de l'Aude. Il entre dans le département par le défilé de Galamus. Curieusement, au lieu de suivre la vallée de Saint-Paul-de-Fenouillet jusqu'à la mer, il serpente à travers des gorges entre les collines. À hauteur de Caramany, un barrage l'arrête depuis les années 90. Il continue de serpenter dans la Salanque, entre Perpignan et l'étang de Salses, avant de se jeter dans la Méditerranée au nord du Bourdigou. Initialement, l'Agly se jetait dans l'étang de Salses ; il a été détourné, peut-être par les Templiers lors de leurs travaux d'assainissement du littoral au XIIIe siècle. À son ancienne embouchure se trouvait un port de débarquement romain.
Parmi les affluents de l'Agly, on trouve le Verdouble (entre Vingrau et Tautavel), le Maury, qui a façonné la plaine de Saint-Paul-de-Fenouillet, et la Boulzane (près de Caudiès-de-Fenouillèdes). À propos du Verdouble, vous pouvez découvrir les gorges de Gouleyrous, un site naturel particulièrement joli.
La Têt
La Têt est le fleuve le plus long des Pyrénées-Orientales. Elle prend sa source dans le lac des Bouillouses, aux pieds du massif du Carlit, et récupère la vallée sous Mont-Louis. Il convient de noter qu'aucune rivière importante ne descend directement du plateau de Cerdagne dans la vallée de la Têt.
Une fois dans la vallée, la Têt descend presque en ligne droite jusqu'à la mer, traversant le barrage de Vinça puis Perpignan. Ce barrage a été construit dans les années 70 pour canaliser ses crues. Au XIXe siècle, des digues ont été érigées à Perpignan pour se protéger des inondations.
La Têt est alimentée tout au long de son parcours par des affluents venant du massif du Canigou ou des collines du Conflent : La Rotja (près de Fuilla), le Cady (près de Vernet-les-Bains), le Caillan (près de Nohèdes), la Castelane (près du col de Jau), et la Llentilla (près de Baillestavy). Sa basse vallée, un affluent particulier, traverse Perpignan, lui conférant ce charme méridional.
Le Tech
Le Tech est le plus méridional des fleuves côtiers. Il prend sa source en Espagne, passe par Prats-de-Mollo, Arles-sur-Tech, Céret, puis rejoint la mer à hauteur d'Argelès-sur-Mer, au "Bocal du Tech". Moins alimenté que les deux autres, il demeure toutefois imprévisible. En 1940, une crue dévastatrice ravagea tous les villages de sa vallée, causant de nombreuses victimes.
Le Tech est alimenté par la Coumelade, qui arrive par le nord juste après le village du Tech. Le Riuferrer, parallèle au Tech, traverse la vallée après Arles-sur-Tech.
Le Sègre
Le Sègre prend sa source dans la vallée de Llo et décrit une grande courbe à travers la Cerdagne. Il traverse Llivia, puis rejoint Bourg-Madame avant de poursuivre sa route en Espagne. Il est rejoint par la Quérol, qui prend sa source entre le lac de Lanoux et Porté-Puymorens et descend la vallée de Carol jusqu'à Bourg-Madame.
L'Aude
L'Aude prend sa source derrière le Roc d'Aude, la montagne qui soutient les pistes de ski des Angles. Elle traverse le Capcir sur son côté droit, du sud vers le nord, passant successivement par le lac de Matemale et celui de Puyvalador. Sur le côté gauche du Capcir, la Lladura serpente entre les Angles et Formiguères avant de renforcer l'Aude. Cette rivière poursuit sa route dans le département voisin homonyme.
La Massane
La Massane est un torrent du massif des Albères. Elle prend sa source au pied du col du même nom, à 968 mètres d'altitude, près de la célèbre tour de la Massane. Ce cours d'eau, long de seulement 22 km, se divise en deux parties distinctes : une première partie montagneuse et un second segment plus calme, en plaine. Il traverse diverses gorges peu profondes du côté du hameau de Lavail, au sud de Sorède, avant de se jeter dans la Méditerranée au niveau du port d'Argelès. Son débit varie en fonction de la pluviométrie locale.
Les barrages hydrauliques
Les barrages hydrauliques sont nombreux dans notre département. Le plus ancien est probablement celui du lac des Bouillouses, construit au début du siècle (de 1904 à 1910) pour alimenter en électricité le petit train jaune. Il a une production de 20 millions de Kilowatts/Heure, ce qui est un gros surplus car le train n'en consomme que 10%.
Il s'agit d'un barrage-poids en maçonnerie dont les fondations sont prises dans le granit. Il mesure 384m de long sur 18,74m de hauteur par rapport au terrain naturel (25,28m par rapport aux fondations). Sa largeur va de 5m en haut à 13m58 au plus bas. Il a une capacité de plus de 19 millions de m3. L'agriculture en consomme 11 millions, les communes de Font-Romeu, Bolquère et Egat en consomment 1 million. Les canons à neige des stations de ski locales en prennent 1/2 millions. Les Bouillouses, c'est le réservoir du département, il peut alimenter ou restreindre l'eau dans les rivières des Pyrénées-Orientales.
En savoir plus sur le barrage des Bouillouses.
Le barrage de Matemale est relativement contemporain, il a été construit entre 1957 et 1959. Il fut bâti en terre sur une assise de granit et d'argile. Il mesure 984m de long sur 33m de haut par rapport au terrain naturel (37m par rapport aux fondations) et pour une épaisseur oscillant entre 6 et 165m de large, ce qui le rend très trapézoïdal. Il a une capacité de rétention de 563 millions de m3, soit 11 fois celle des Bouillouses.
Le barrage de Puyvalador, construit entre 1925 et 1932, est un barrage-poids fait en béton sur une assise de schistes. Il mesure 161m de long sur 31m de haut (terrain naturel, 39m sur hauteur de fondation) et il a une largeur qui va de 3m60 à la crête à 30m au niveau des fondations. Il contient 36 000 m3, c'est donc un "petit" lac artificiel.
En savoir plus sur le barrage de Puyvalador.
Le barrage du Lanoux alimente en électricité le département voisin de l'Ariège. Il fut construit entre 1657 et 1960 sur le schéma d'un barrage-voûte. Il mesure 176m de long sur 45 de haut. Son épaisseur est de 2m en crête et 6m aux fondations. Il a la plus petite capacité du département, soit 25 millions de m3.
Le barrage de Vinça fut construit en 1976 dans le but d'écrêter les crues de la Têt et d'alimenter le canal d'irrigation de Corbère. Il mesure 55 mètres de haut, 191 mètres de large et a nécessité 142 000 tonnes de béton. Il a une capacité de rétention d'eau de 25 millions de mètres cubes. L'une de ses plages est la plage des Escoumes, sur laquelle la ville de Vinça a organisé une vraie station balnéaire à l'intérieur des terres.
En savoir plus sur le barrage de Vinça.

Le barrage sur l'Agly

Le barrage sur l'Agly
Le barrage de Caramany est le plus récent. Il a été mis en eau la première fois en novembre 1994. Il contient 30 millions de m3 et mesure 57 mètres de haut et 260 de large. Du 1er juin au 30 juin, il entre dans sa phase de remplissage. Du 1er juillet au 30 septembre, c'est le déstockage et du 1er octobre au 31 mars il est quasiment vide, prêt pour l'écrêtement d'éventuelles crues. Une petite remarque à son sujet : Son nom officiel est le barrage de l'Agly, et il est construit en fait sur la commune de Cassagnes, et la retenue d'eau est à 10% sur cette commune, et à 90% sur celle de Caramany. En fait, l'appellation "Barrage de Caramany" vient du fait que c'est le village le plus proche, celui duquel on voit le mieux le plan d'eau.
En savoir plus sur le barrage de Caramany.
Les canaux
Quand on parle de canaux d'irrigation, il faut bien comprendre qu'il s'agit de petits canaux étroits, d'un mètre de large approximativement, qui prennent leurs sources sur un site naturel et amènent l'eau dans des terrains n'en ayant pas. Les canaux sont très importants dans le département, c'était une énergie pour faire tourner les moulins des villages. Puis l'eau est devenue utile pour l'industrie, en particulier les forges catalanes, et à présent ils servent à l'irrigation des terres maraîchères ou fruitières (surtout depuis le XIXe siècle).
Ils sont aujourd'hui gérés par des ASA : Associations Syndicales Autorisées. Il existe 240 ASA dans le département qui gèrent plus de 300 canaux. Bien sûr, il est hors de propos de décrire ici tous les canaux, mais mettons en lumière quelques particularités.
Le canal d'Elne porte un nom particulièrement peu explicite. Il prend son eau à Ortaffa, au lieu-dit "La Rescola", puis se sépare rapidement en deux bras, un allant vers Latour-bas-Elne, l'autre vers St Cyprien. Ces deux bras se jettent dans la lagune de St Cyprien. Il était utilisé pour alimenter 7 moulins, tous du XIVe siècle sauf un de 1534 (actuellement sur l'emplacement de l'usine à glace), et un peu pour l'agriculture. À partir du XIXe, il devient à vocation agricole uniquement, pour les primeurs du Roussillon. Les vergers de la plaine du Roussillon reçoivent cette eau.
Historiquement, on a une trace de ce canal en 1184, où le seigneur d'Ortaffa accorde "à Dieu, à Ste Eulalie, à l'évêque, au clergé et à la communauté des habitants" la concession des eaux du Tech. C'est un canal réservé à Elne, mais plus tard St Cyprien et Latour-bas-Elne pourront en utiliser les eaux (la nuit seulement !). C'est un canal qui fut construit sur les vestiges d'un plus ancien, attesté au Xe siècle. Il mesure 17 km de long.
Le canal d'irrigation agricole "Bohère" est le plus long du département : 41 km. Il fut construit au XIXe siècle, et traverse de très nombreux ouvrages d'art : aqueducs, siphons, etc. Il a pour départ le village de Serdinya, où il capte une partie de l'eau de la Têt et descend la vallée jusqu'au Ribéral. Il a été mis en eau en 1879 mais n'est resté vraiment efficace que jusqu'en 1933.
Autres canaux : Il existe un canal prenant sa source au Tech et allant jusqu'à Laroque-des-Albères, passant par Montesquieu. Il a été mis en eau en 1877 et couvre 900 hectares arrosables. En Fenouillèdes, Nohèdes a un canal d'irrigation de 8 km de long, presque horizontal, ce qui est une curiosité.
Des canaux très anciens : Les plus anciens canaux existant encore sont ceux du Vernet (attesté en 863), Els Molis à Céret (866), Finestret (1282). Au XIIIe siècle, nous avons une trace également du canal de Sahorle, qui fut creusé grâce à l'accord du seigneur Arnaud de Corsavy et de son épouse Géralde d'Urtx. À Villefranche-de-Conflent, le canal s'appelle canal d'Enconomary, créé dans les années 1200 par les frères du cloître des Franciscains pour faire tourner le moulin à farine du jardin Martin, au pied du pont du Faubourg. Il prend l'eau de la Têt au Mas de l'Astourg, avec des ramifications et prolongements faits au XIXe et XXe siècle et alimente l'usine "Keller et Leleu" ainsi que la SNCF. Il fait 4 km de long.
Rivières de Perpignan intra-muros
Lorsqu'une population investit un nouveau territoire, il est tout naturel qu'elle se concentre sur des collines, à proximité de petites rivières. C'est ce qui s'est passé pour Perpignan quand, à partir du début du IXe siècle, les premiers migrants arrivèrent en Roussillon, et trouvèrent deux collines modestes ornées de trois terrasses douces assises devant un petit cours d'eau, et non loin d'un fleuve paisible, mais tous deux aux réactions rageuses. Ils s'installèrent donc entre deux ruisseaux descendants des collines, ruisseaux dont on peut encore de nos jours suivre la trace dans les rues de Perpignan.
À l'est, le ruisseau séparant le Puig des Esplanades aboutit derrière St Jean, suivant les rues actuelles Llucia, de l'Université et du Ruisseau. À l'ouest, le ruisseau naissant au pied de l'actuelle citadelle (Puig del Rei) descend en suivant la rue Grande la Réal, la place des Poilus, la rue de l'Ange. Plus à l'ouest, le ravin dit de "Saint-Mathieu" descend en suivant les actuelles rues Dugommier et la place d'En Vestit. Ces trois ruisseaux rejoignent la Basse, qui prend sa source à proximité de Thuir, se grossit sur son parcours de différents petits ruisseaux, dont le Ganganell, les deux cours d'eau citées, vers l'emplacement de la future place Arago, ainsi que l'Aixaugador, avant de rejoindre la Têt qu'elle accompagnera jusqu'à la mer.
Forages artésiens
C'est à Toulouges que, le 27 mars 1829, M. Fraisse, un employé de la société royale d'agriculture, détermine l'emplacement du premier forage profond du département. Le 15 juin de la même année, il atteint la profondeur voulue, 41 m. L'eau jaillit à 1,50 m au-dessus du sol, au rythme de 1,4 litre par heure. Ce fut le début de l'irrigation du Roussillon par forage artésien.
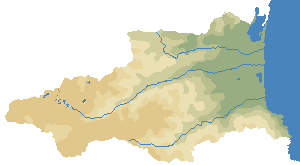

 Les Pyrénées-Orientales
Les Pyrénées-Orientales